En 1866, dans son ouvrage Morphologie générale des organismes, Ernst Haeckel (1834-1919) nomma Oecologie « la science des relations des organismes avec le monde environnant, c'est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions d'existence »[1]. Visionnaire, le jeune homme de 32 ans ajouta : « L'écologie, ou l'étude de l'équilibre de la nature, partie de la physiologie qui n'est pas encore mentionnée comme telle dans les manuels, promet de porter sous ce rapport les fruits les plus brillants et les plus surprenants. » Imaginait-il vraiment le succès planétaire qu’allait acquérir son néologisme[2] et le rôle central qu’allait tenir cette science un siècle plus tard ? Le terme allemand Oecologie – orthographié de nos jours Ökologie – fut traduit en anglais par œcology (1873) et en français par écologie (1874). L’écologie faisant l’objet d’innombrables articles, ouvrages, émissions, débats, sommets internationaux, je vais plutôt me concentrer sur le concept « écologie » lui-même, après une brève présentation de son auteur.
Né dans une famille allemande protestante cultivée, le jeune Ernst lisait Goethe, Schiller, Humboldt et se passionnait pour les plantes et le dessin. S’il devint médecin en 1858 sur le conseil paternel, il se réorienta rapidement vers l’anatomie comparée et la zoologie. Grand voyageur, à l’instar de Darwin qu’il rencontra en 1866 et dont il fut l’apôtre en Allemagne, Haeckel observa le monde vivant sous de nombreux aspects. Dans ce contexte il forgea le terme Oecologie en associant deux mots grecs : οἶκος [oïkos] et λόγος [logos]. Je ne m’appesantis pas sur le suffixe -logie qui signifie « discours, étude, théorie ». Plus instructif est le premier terme – οἶκος – qui signifiait « maison, lieu d’habitation ».
Οἶκος provient de la racine proto-indo-européenne -weik* qui désignait l’unité de vie sociale, concept clé de toute société humaine. Ainsi, le concept οἶκος, beaucoup plus vaste que ce qu’on nomme actuellement une maison, était présent dans un grand nombre de mots, souvent conservés tels quels – translittérés – en français :
- οἰκονομία [oïkonomia], littéralement « administration d’une maison » a donné « économie » ;
- διοίκησις [diokèsis], « gouvernement d’une maison » est devenu « diocèse » ;
- παροικία [paroïkia], « établissement à proximité ou à l’étranger » s’entend dans « paroisse » ;
- οἰκουμένη [oïkouméné], « terre habitée » se retrouve dans « œcuménique ». Notons que diocèse, paroisse et œcuménique n’avaient initialement aucun rapport avec une organisation ecclésiastique.
- μέτοικος [métoïkos], « étranger à la maison » a donné « métèque ».
Haeckel eut l’idée d’élargir le concept οἶκος – cellule spatiale fondamentale des humains – à tous les êtres vivants ainsi qu’au monde inanimé. L’extension de la « maison » à tout ce qui existe préfigure le monisme dont Haeckel se fera bientôt l’ardent promoteur[3]. N’allons pas plus loin dans cette direction et revenons à la maison !
Selon Haeckel, l’écologie porte l’attention sur une vision élargie de la maison. Pour nous, humains, quel sens revêt la maison ? Ce mot vient du latin mansionem, accusatif de mansio « séjour, halte », substantif lié au verbe manere, lui-même issu du grec μενω [ménô] : « demeurer, séjourner ». En français, une « manse » était une maison avec un lopin de terre cultivée, autrement dit un lieu viable. En langue d’oc, on parle de « mas ». « Maison », « manse », « manoir », « demeure », « mas » et « masure » partagent la même racine et désignent des lieux où l’on demeure, des lieux de « permanence ». La maison est l’endroit où l’on se trouve, au sens propre comme au sens figuré.
La maison intérieure
Dans l’un de ses ouvrages fondamentaux[4], Rudolf Steiner écrivait : « De même que, dans l’espace physique, on détermine un objet ou un lieu à partir d’un point précis, de même ce doit être aussi le cas dans cet autre monde [Steiner évoque le monde spirituel] que l’on a atteint. Il faut se chercher quelque part un lieu que l’on explore tout d’abord très précisément et dont on prend spirituellement possession pour soi-même. En ce lieu, il faut se fonder une patrie spirituelle et mettre ensuite tout le reste en rapport avec cette patrie. L’être humain qui vit dans le monde physique voit, après tout, lui aussi toutes choses comme l’y inclinent les représentations qu’il a de sa patrie physique. Un Berlinois décrit tout naturellement Londres autrement qu’un Parisien. Il en va autrement dans la patrie spirituelle que dans la patrie physique. Dans cette dernière on est né sans y être pour rien, en elle on a, pendant sa jeunesse, assimilé instinctivement une somme de représentations, à partir desquelles tout est désormais tout naturellement éclairé. La patrie spirituelle [die geistige Heimat], en revanche, on l’a formée soi-même en pleine conscience. C’est pourquoi on juge aussi dans une totale et lumineuse liberté en la prenant pour point de départ. Dans le langage de la science occulte, on appelle ce processus de formation d’une patrie spirituelle “construire un refuge” [eine Hütte bauen]. » Le refuge dont parle Steiner peut-il être mis en rapport avec l’οἶκος de Haeckel ? Si le monisme haeckelien réfutait l’existence d’un Créateur, Haeckel défendait cependant un panthéisme ou un panpsychisme inspiré de Goethe et de Spinoza. Dans ce contexte, il parlait notamment de mémoire cellulaire (Zellgedächtnis) et d’âmes du cristal (Kristallseelen), considérant que toute chose était animée, c’est-à-dire douée d’âme. Par ses qualités psychiques, voire spirituelles, l’οἶκος de l’écologie haeckelienne ne peut être réduite au simple biotope, aussi la quête écologique de la « maison » selon Haeckel est-elle finalement assez proche de la construction du « refuge » suggérée par Steiner. L’écologie humaine questionne la place et le rôle que se donne l’individu dans la biosphère. L’attitude écologique est donc intimement liée au sens que l’individu donne à sa propre existence terrestre. Indissociable de l’écologie, l’ontogenèse en est même le principal artisan. L’écologie, au sens où Haeckel l’a définie, interpelle chaque être humain dans sa conscience ; elle ne peut se résumer à des mots d’ordre « écolos », aussi vertueux soient-ils.

Trois écologistes méconnus
Si l’écologie est un aspect de la conscience humaine, nombreux sont les auteurs ayant contribué à l’écologie sans avoir été répertoriés « écologistes ». Mentionnons trois d’entre eux.
En 1798, dans sa première publication, Novalis (1772-1801) écrivait : « Nous sommes en mission : appelés à la formation de la terre (zur Bildung der Erde) »[5]. Au 21ème siècle, on a tendance à penser que la formation de la terre est une histoire ancienne puisqu’il y aurait belle lurette que le Big Bang s’est produit. Mais Novalis n’était pas que poète : après des études de philosophie et de droit, il avait étudié à l’école polytechnique de Freiberg et acquis de solides bases en géologie. La mission dont il parle pourrait être envisagée comme un principe écologique fondamental.
En 1845, Henry David Thoreau (1817-1862) allait passer une année dans la cabane qu’il s’était construite dans les bois. Il cherchait sa juste place dans le monde, parmi ses contemporains qu’il ne cessa de rencontrer car il ne cherchait pas à fuir la société comme certains ermites le font. Cette expérience et son regard critique sur la société humaine l’amenèrent à publier en 1854 Walden ou la Vie dans les bois[6], ouvrage où naturalisme et éthique se fondent en un tout, fleuron d’écologie : « Il y a chez l'homme qui construit sa propre maison un peu de cet esprit d'à-propos que l'on trouve chez l'oiseau qui construit son propre nid. Si les hommes construisaient de leurs propres mains leurs demeures et se procuraient la nourriture pour eux-mêmes comme pour leur famille, simplement et honnêtement, qui sait si la faculté poétique ne se développerait pas universellement, tout comme les oiseaux universellement chantent lorsqu'ils s'y trouvent invités ? » Avec sa cabane, Thoreau concrétisa sa maison intérieure : « Qu'il faut être stupide pour penser trouver son Eldorado n'importe où, hormis là où l'on vit ! »[7] .
En 1885, Friedrich Nietzsche (1844-1900) publiait Ainsi parlait Zarathoustra, un livre pour tous et pour personne dans lequel Zarathoustra affirme « Dieu est mort »[8]. Le propos apparemment déicide et iconoclaste contient cependant une préoccupation que je qualifie d’écologique : « Mes frères, restez donc fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d’espérance d’au-delà de la terre ! »[9]. Être fidèle à la terre, c’est œuvrer dans la matérialité de la terre par respect envers la « maison ». Cet auteur réputé « anti christique » énonce au fond un principe profondément écologique, au sens haeckelien du terme.
L’écologie – écho du logis, de la maison, de l’habitat, de l’habitus – invite à reconsidérer bon nombre d’habitudes.
Notes
[1] Ernst Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, Reimer 1866 (p286)
[2] Plusieurs des nombreux néologismes forgés par Haeckel sont encore en usage : ontogénie, phylogénie, phylum, monophylétique, polyphylétique, promorphologie, monère, métazoaire, cellule souche, gastrulation, écologie, chorologie.
[3] En 1892 il publie Le monisme (Das Monismus) et fonde la « Ligue moniste allemande » (Deutsche Monistenbund) en 1906.
[4] Rudolf Steiner, Comment parvient-on à des connaissances des mondes supérieurs ? Novalis 1993 [GA10, 1905]
[5] Novalis, Blüthenstaub (Grains de pollen) in revue Athenaeum 1798
[6] Henry David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois, Espaces libres – Idées 2017
[7] Henry David Thoreau, Je suis simplement ce que je suis : Lettres à Harrison G.O. Blake, Finitude Éditions 2007
[8] Friedrich Nietzsche, Ainsi parla Zarathoustra, Rivages poche 2002 (p32)
[9] Friedrich Nietzsche, Ainsi parla Zarathoustra, Rivages poche 2002 (p33)
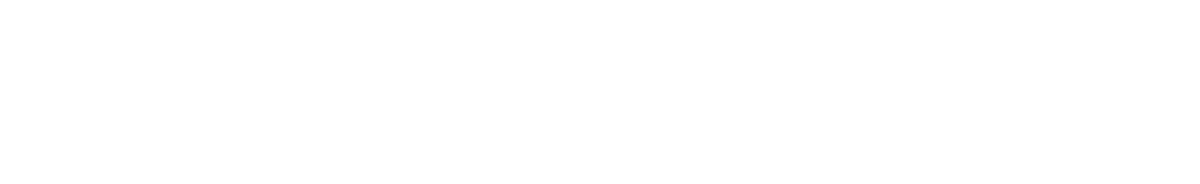
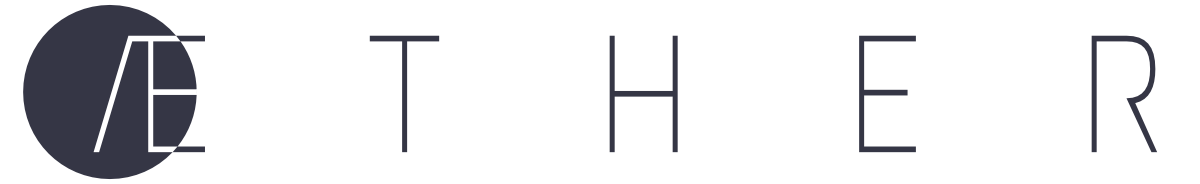
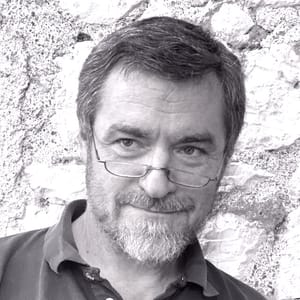


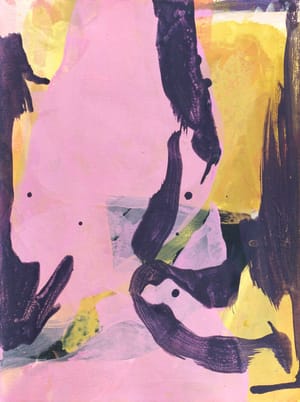






Discussion pour membres