La pensée sociale de Rudolf Steiner se fonde sur sa conception de l’individualisme éthique et de la liberté. Il est cependant souvent considéré comme un penseur qui prône une éthique prescriptive, comme quelqu’un qui défend des systèmes moraux précis. Cette vision fausse sa pensée, dont le cœur est l’autodétermination individuelle. Je tenterai ici de caractériser l’individualisme radical de Steiner et de montrer que sa pensée éthique n’est pas prescriptive. En explicitant une idée qui n’est qu’implicite dans sa formulation de l’individualisme – ce que j’appelle la « négativité du Je » – j’espère mettre en évidence le fait que son individualisme éthique est une composante essentielle de sa pensée sociale.
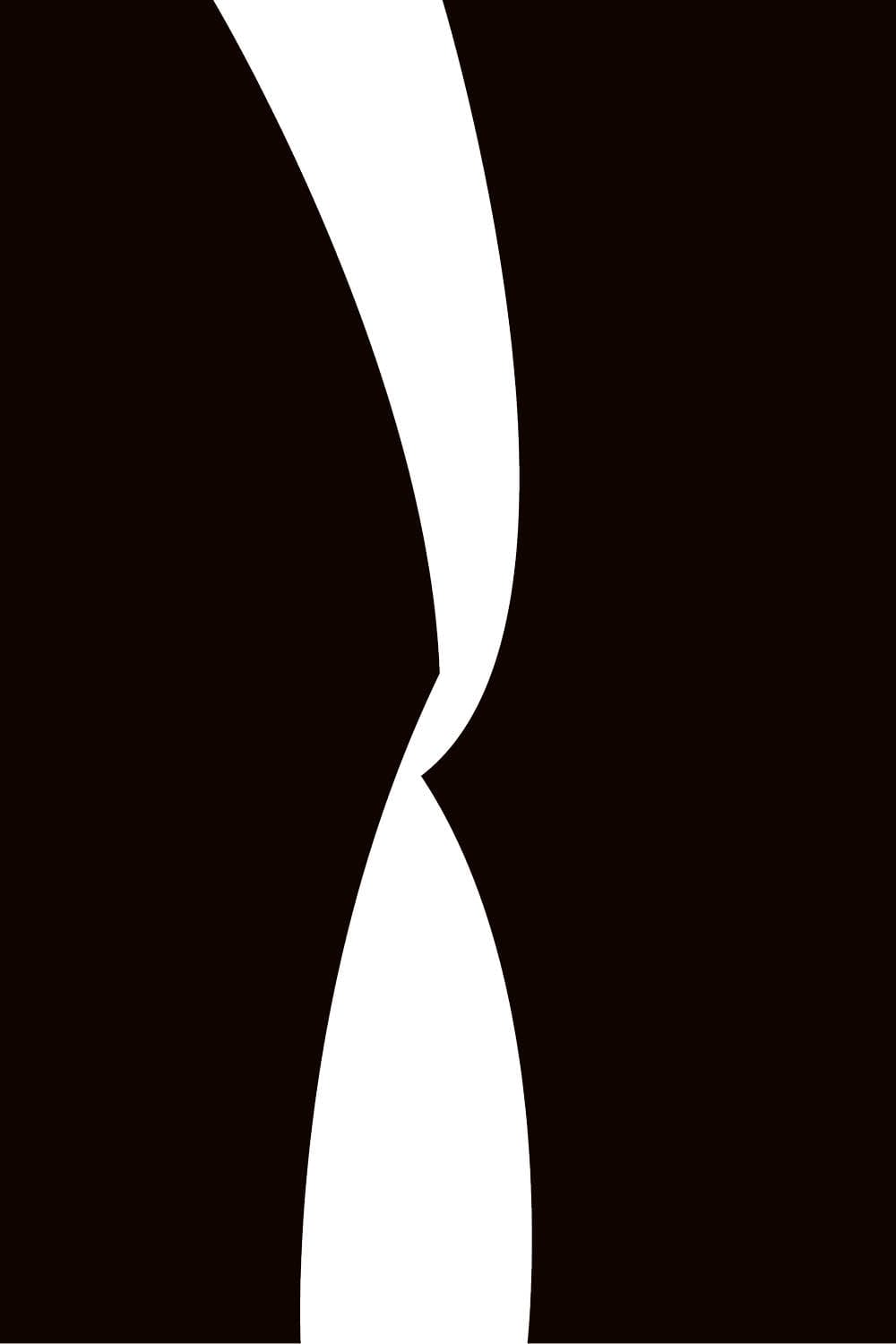
L’identité négative
Dans sa forme minimale, le Je est une activité visant à nier toute détermination positive de l’identité. Par « détermination », j’entends toute caractéristique utilisée pour définir l’identité humaine : ethnicité, sexe, nationalité, classe sociale, orientation sexuelle, origines, famille, confession religieuse, voire biographie personnelle. La conscience de soi se constitue par la négation de toutes les déterminations qui lui sont étrangères – et tout lui est étranger. Aucune détermination n’est propre au soi ; du point de vue de la véritable conscience de soi, toutes sont extérieures. Même si certaines conditions matérielles peuvent être nécessaires à l’être humain, nous devons les rejeter lorsque nous disons « je ». Dans cet acte, la conscience de soi émerge comme la conscience de son indépendance envers les déterminations et affirme son identité précisément en affirmant sa différence par rapport à celles-ci. En ce sens, le Je est une activité de négation.
On ne peut rien dire a priori sur le Je. On peut définir une table, un arbre, un autre objet ou un état psychologique et les décrire en termes substantiels. Mais le Je échappe à toute prédiction. Nous pouvons faire des déclarations telles que « Hans est suisse » ou « Laura est une femme homo sapiens sapiens, née en 1981 ». Mais ces affirmations ne se réfèrent pas au Je de ces individus, elles ne font que décrire des déterminations. Le Je n’existe pas en tant que chose. Le langage énonciatif – il en va peut-être autrement dans le langage poétique ou imaginaire – met en évidence cette restriction : tout prédicat que l'on souhaite attribuer au « je » échoue à parler de quoi que ce soit.. Néanmoins, on peut affirmer que le Je existe, car c’est l’activité négative qui constitue la conscience de soi et il se pose lui-même par l’action.
On pourrait dire « je », mais en réalité vouloir dire autre chose. Pensons, par exemple, aux idéologies contemporaines qui, dans leur tentative de remettre en question les conventions sociales perçues comme oppressives ou de combattre les préjugés culturels, réduisent l’identité individuelle à des déterminations générales. Ce phénomène est particulièrement évident dans les mouvements activistes qui se concentrent sur l’orientation sexuelle, le genre ou la race et qui, paradoxalement, occultent précisément l’individualité de ceux qu’ils veulent renforcer. Avec de tels points de vue, on définit et juge principalement les individus par leurs déterminations. On ne dit pas « je suis moi », mais « je suis [race, sexe, orientation sexuelle, nationalité, etc.] » ; les revendications identitaires personnelles prennent donc la forme : « je suis non-moi ». Mais toute revendication de ce type interprète mal la nature du Je. La véritable conscience de soi s’exprime de manière minimale comme « je ne suis pas pas-moi » : je ne suis pas défini par ma race, mon sexe, ma nationalité ou toute autre détermination. Mon identité ne peut pas être réduite à ces déterminations ; au contraire, elle s’enracine dans la liberté que possède le Je de les transcender et d’agir au-delà de celles-ci.
Je perçois clairement que, pour Steiner, la négation active de l’identité extérieure est cruciale pour comprendre la liberté, même s’il ne l’exprime pas en ces termes. Max Stirner, le philosophe de l’égoïsme du XIXe siècle ayant influencé la première pensée philosophique de Steiner, a décrit ouvertement la négativité du Je : « Si Dieu, si l'humanité, comme vous l'affirmez, ont suffisamment de substance en eux pour être tout en tout, alors je sens que cela me manquera encore moins et que je n'aurai pas à me plaindre de mon « vide ». Je ne suis [pas] rien au sens du vide, mais le rien créateur, le rien à partir duquel je crée tout en tant que créateur. »1
Détermination par autrui et autodétermination
Le Je n’est pas seulement une relation négative aux déterminations ; il est aussi le fondement de l’autodétermination créative. Ce n’est que dans l’acte libre que le Je se met en scène et devient quelque chose de positif lorsqu’il agit. Une telle action ne résulte pas de l’adhésion à des normes ou à des vertus hétéronomes, mais de motivations autonomes (j’entends par « hétéronome » une action qui est déterminée de l’extérieur du Je, donc par autrui, et par « autonome » une action qui est déterminée par le Je, donc autodéterminée). Comme l’hétéronomie de la volonté se déguise fréquemment en vertu et cache la vraie nature du Je, on croit souvent agir librement, même si l’action est hétéronome et donc, non libre. L’enfer est pavé de bonnes intentions. Les principes éthiques ou les valeurs que nous reconnaissons dans une action véritablement libre sont des propriétés émergentes de l’activité créatrice du Je et ne résultent pas de principes éthiques prédéterminés.
Dans la mesure où les vertus se trouvent dans des actions autodéterminées, elles n’existent pas en tant qu’idéaux fixes auxquels on doit se tenir ; on les saisit conceptuellement après coup, une fois qu’elles sont révélées à partir de l’activité créatrice du Je. Alors seulement, devenues des motifs d’actions déterminées par autrui, on peut les utiliser comme principes pratiques. Il est vrai qu’aucun moyen extérieur ne permet de distinguer les actions autodéterminées des actions déterminées par autrui, sauf dans des cas très évidents. Néanmoins, on peut reconnaître dans une action autonome comme la justice, le courage ou l’honnêteté. De tels cas montrent que les vertus sont des concepts émergents de l’action humaine dans l’esprit de l’observateur, et non des idées déterminantes qui donnent forme à l’action elle-même ou la précèdent. Phénoménologiquement, les vertus sont donc des propriétés « émergentes » de l’action humaine libre, et non une série de principes pratiques que l’individu devrait appliquer.
Intuition et amour de l’action
Pourquoi Steiner parle-t-il d’intuitions « morales » ? Le terme est trompeur et redondant. On pourrait le comprendre comme désignant des intuitions dont le contenu est moral, par opposition à celles qui n’ont pas de contenu moral. Ainsi, si la « moralité » était basée sur des contenus tels que la générosité, la responsabilité envers l’environnement ou envers autrui, ou la compassion, l’honnêteté, etc., il faudrait considérer comme morale toute action qui présente ces contenus, indépendamment de sa motivation. Mais les actions déterminées par autrui ne peuvent pas être morales par nature. Une action morale ne peut être qu’une action qui vient de l’intérieur, du Je, une action autodéterminée et originelle. La moralité d’une intuition ne réside pas dans son contenu, mais dans son origine autonome : elle naît du discernement de l’individu dans le monde.
L’ajout de « morale » à « intuition » n’apporte pas de contribution essentielle à la compréhension de l’action libre. Le terme « morale » se réfère simplement à une intuition à partir de laquelle l’individu agit librement. De même, l’individualisme « éthique » n’est qu’un individualisme bien compris.

Steiner souligne que ce ne sont pas seulement les intuitions qui mènent à une action libre, mais aussi l’amour de l’action. Que veut-il dire par là ?
« Si j’agis par amour pour l’objet, alors seulement je peux dire : j’agis moi-même. À ce niveau de moralité, ce n’est pas tel maître au-dessus de moi, telle autorité extérieure ou telle voix soi-disant intérieure qui me guident. Mon acte n’est soumis à aucun principe venant du dehors, parce que j’ai trouvé en moi-même la cause d’agir, l’amour de cette action. Je n’examine plus, au moyen de l’intellect, si mon action doit être jugée bonne ou mauvaise ; je l’accomplis parce que je l’aime. »2
Steiner le pense littéralement. Pour l’individu libre, rien ne peut justifier une action si ce n’est l’amour que le Je a pour cette action, et inversement, le Je ne peut aimer que les actions librement imaginées. L’essentiel est de connaître la différence entre une inclination authentique à agir selon une certaine intuition (a) et le désir d’agir selon une idée ou un concept qui procure un sentiment positif (b). Selon Steiner, nous ne sommes libres que lorsque nous agissons conformément à la variante a. Dans ce cas, ce sont nos intuitions (notre compréhension intellectuelle directe du monde) et notre amour pour l’action que nous avons l’intention d’entreprendre (une véritable inclinaison à sa réalisation) qui constituent le motif et le moteur de l’action. Il est important de ne pas confondre la variante (a) avec la variante (b), dans laquelle l'intuition véridique et l'inclination à agir selon cette intuition sont remplacées par des concepts déjà acquis et des émotions positives à l'égard d'agir sur la base de ceux-ci.
La dignité humaine depuis le futur
Pour comprendre ainsi le Je et la liberté, il faut regarder dans un « abîme », un état dans lequel il n’y a ni règles ni garanties et où le sentiment de dignité morale ou de sens n’existe pas. Il faut d’abord admettre que l’on n’est « rien ». C’est une perspective décourageante pour l’âme sensible, qui doit se défaire de la sécurité des systèmes moraux et idéologiques, ainsi que du sentiment de dignité – ou de manque de dignité – que procure l’appartenance à une identité. Il est peu probable que l'âme soit attirée par le nihilisme glacial du moi conscient de soi par inertie. Au contraire, elle sera attirée par tout ce qui lui donne un sentiment d'existence digne, souvent quelque chose qui parasite les hiérarchies de valeurs morales socialement perçues.
C’est précisément la négativité radicale du Je et son indépendance qui constituent la véritable source de la dignité humaine. Être individualiste, c’est donc être quelqu’un qui comprend où se trouve la dignité humaine. Le Je est le néant créateur qui donne sa dignité à l’être humain. Seul l’individu peut transcender la causalité matérielle (naturelle, sociale, psychologique, etc.) qui, sinon, régnerait sur l’ensemble de la vie humaine. La dignité humaine ne peut pas résulter de l’appartenance à une espèce, car elle est abstraite et impersonnelle. Elle ne peut pas non plus résulter de l’appartenance à un groupe particulier, qui suppose l’exclusion d’autres personnes. La dignité humaine doit être universelle. La dignité humaine universelle réside exclusivement dans le potentiel du Je à se poser lui-même et elle est donc toujours tournée vers l’avenir. La dignité humaine n’est pas fondée sur ce que l’on est, mais sur le fait que l’on peut créer à chaque instant quelque chose ex nihilo. Elle se manifeste dans l’histoire, mais à l’envers, du futur vers le passé.

Le nihilisme créatif
La caractéristique la plus marquante de la vie spirituelle contemporaine est sans doute le nihilisme, par lequel j’entends l’érosion de tout sens dans un monde sans transcendance. Ce nihilisme se manifeste par deux réactions opposées. D’un côté, il y a le relativisme, où les gens ne trouvent rien de fondamental dans la vie humaine, que ce soit sur le plan spirituel, politique, social ou scientifique – une forme d’autodestruction culturelle. De l’autre côté, il y a une tendance conservatrice qui tente de restaurer un passé où les valeurs culturelles étaient fermement enracinées dans la foi religieuse et où la vie était remplie de sens grâce à un fondement spirituel transcendant. Ces deux réactions ont un point commun : elles considèrent le nihilisme comme une érosion des valeurs dans la vie culturelle. En ce sens, le nihilisme reste périphérique à l’individu, qui est conçu comme un pion impuissant à peine à flot alors qu’il est traîné ici et là par les forces culturelles. Comme on le sait, Nietzsche a déclaré : « Dieu est mort ! Dieu reste mort ! Et c’est nous qui l’avons tué ! Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers ? »3. Cet acte est irréversible ; les tentatives de restauration des structures traditionnelles se résument souvent à s’accrocher à un cadavre, tandis que le relativisme s’enfonce dans un océan d’insignifiance où le Je n’est qu’illusion. Les deux réactions échouent à affronter avec succès les implications de l’ère dans laquelle nous vivons. La question à laquelle nous sommes confrontés n’est pas de savoir si nous devons annuler la mort de Dieu ; elle est de savoir comment faire face aux conséquences du meurtre. Allons-nous désespérer face au sang sur nos mains ? Ou devenir la source d’un sens nouveau ?
Le nihilisme s’enracine au cœur de la conscience humaine. Le soi est une activité négative, pas une illusion. L’accepter est le véritable nihilisme, non pas le désespoir du post-modernisme relativiste ou la justification d’un anachronisme réactionnaire consistant à s’accrocher à des certitudes perdues, mais un nihilisme créatif qui reconnaît le néant du soi comme fondement de la liberté et comme véritable source de la spiritualité humaine.
L’individualisme, ainsi compris, peut-il fonder une société saine ? Est-il possible que des individus désirent des résultats fondamentalement incompatibles entre eux ? L’individualisme ne conduit-il pas inévitablement au relativisme ? Pour Steiner, ce n’est pas le cas : les individus libres ne peuvent pas être fondamentalement en conflit les uns avec les autres, car leurs intuitions sont des aperçus du même monde.
Liberté, vertus et question sociale
L’émergence des vertus mentionnée ci-dessus est directement liée aux implications plus larges de la pensée de Steiner. De même que les vertus émergent de la libre activité du Je, des processus sociaux et économiques sains émergent d’une société fondée sur des individus libres. Une société qui favorise la vraie liberté produira naturellement des structures sociales saines. Les caractéristiques d’un organisme social sain correspondent aux vertus humaines dans la mesure où elles sont émergentes. Toutes deux résultent de l’autodétermination, et non de principes imposés, aussi souhaitables qu’ils puissent paraître. Cette vision des choses remet en question toute tentative d’associer la pensée de Steiner à la social-démocratie par exemple, car celle-ci repose sur des idéaux moraux collectifs que les gouvernements imposent dans la sphère économique et la sphère culturelle.
En institutionnalisant des vertus ou des valeurs, la social-démocratie sape la liberté individuelle, essentielle à la vie culturelle et spirituelle. Les efforts de l’État pour définir des normes culturelles ou une éthique économique réduisent souvent l’autonomie individuelle à l’adhésion à des idéaux collectifs. Le concept de liberté de Steiner exclut une telle ingérence politique. Des valeurs imposées, aussi bien intentionnées soient-elles, ne peuvent pas déterminer la culture sans mettre en danger l’émergence spontanée de vertus que seuls des individus libres peuvent créer. Dans ce contexte, quiconque comprend ce concept de liberté ne peut se tourner de manière conséquente vers les principes de la social-démocratie. Les idées sociales de Steiner sont incompatibles non seulement avec la social-démocratie, mais aussi avec le socialisme, le nationalisme, le conservatisme et toute forme d’autoritarisme, indépendamment de leur prétendu fondement moral.
La liberté n’est pas seulement un idéal personnel, c’est une question fondamentale pour l’individu, et donc pour la vie culturelle de la société. Ce n’est que lorsque les individus agissent de manière autonome à partir de la négativité du Je et créent du sens et des vertus par une action véritablement libre que la société elle-même peut être spiritualisée.
Adaptation française
Béatrice Petit & ÆTHER X
Source
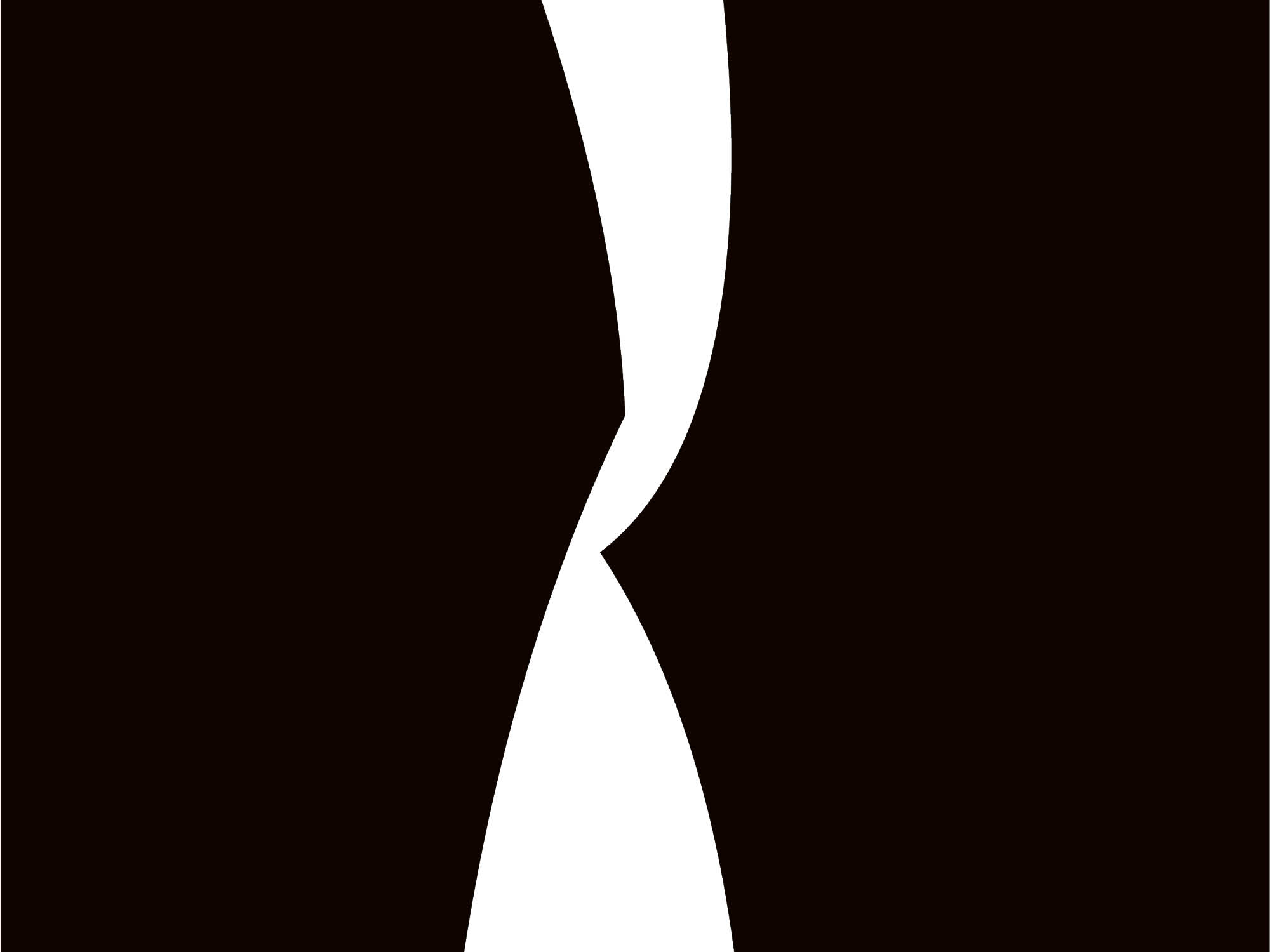
Notes
1 | Max Stirner, L’unique et sa propriété.
2 | Rudolf Steiner, La philosophie de la liberté, EAR, 1979, p. 154.
3 | Friedrich Nietzsche, Le gai savoir. Aphorisme 125, L’insensé.
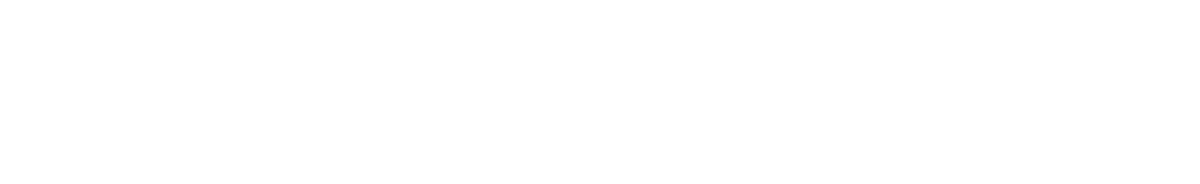
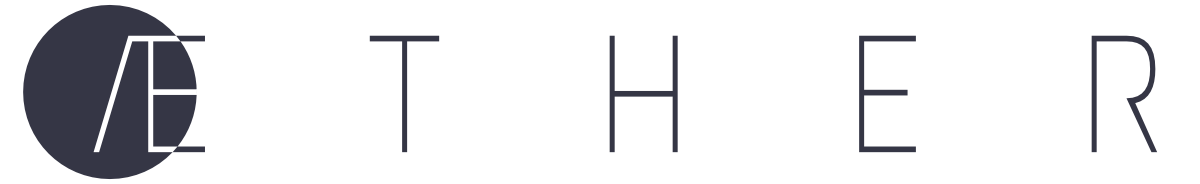



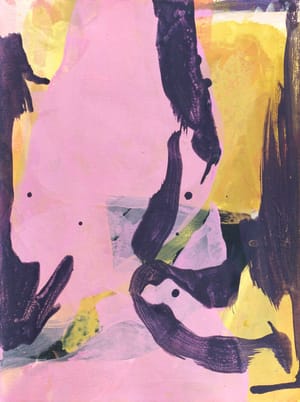




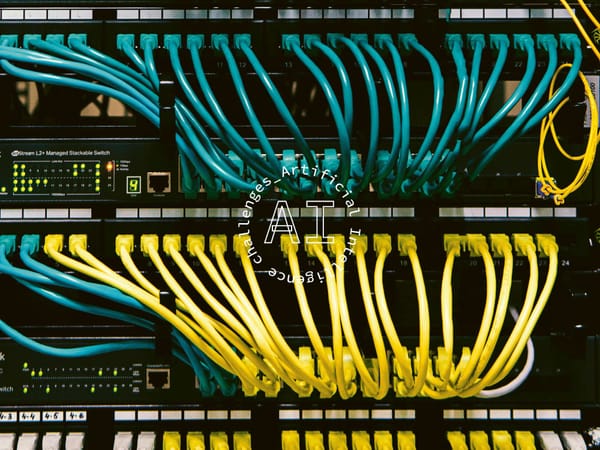


Discussion pour membres