Il y a un seuil entre l’été et l’hiver. Dans de nombreuses régions, notamment en Allemagne et en Suisse, se dressent des pierres, discrètes et silencieuses. On peut s’y exercer à la gravité automnale : la verticalité et la fermeté comme transition entre la vie extérieure dans la lumière et le recueillement intérieur. Peut-être qu’au début et à la fin, un son michaélique résonnera doucement, non pas comme un slogan, mais comme une question adressée au Je.
C’est une connaissance silencieuse qui réside dans le corps : le regard, qui s’étend loin en été, revient à la maison en automne. Dans ce retour à la maison, la pierre dressée peut être notre vis-à-vis – non pas une énigme à résoudre, mais une présence à rencontrer. En la considérant non pas comme une simple curiosité, mais comme une forme à part entière, on ouvre un chemin qui dépasse l’explication et la simple sensation : une perception qui, par sa polarité, ramène la pensée à elle-même, non pour créer le sens, mais pour le découvrir.
La pierre qui crée le lieu
Imaginez un paysage de landes et de marais – vaste et plat, un tapis d’herbes basses et de graminées, un sol terne et acide, traversé par de fines veines d’eau. Ici et là, quelques jeunes bouleaux. Effleurant à peine l’horizon, ils parlent davantage du vent que du bois. Au loin, un bras de mer, des îles et péninsules en longues lignes plates. La mer n’est pas une surface, mais un souffle dans le regard. Tout est horizontal, fluide ; rien ne crie « ici », rien ne retient. Les sons ne nous parviennent pas comme des voix, mais comme des courants – un vent qui caresse plus qu’il ne pousse.
Et puis il y a une pierre, un gardien solitaire devant un cercle de pierres au loin. Pas une pyramide, pas un spectacle, plutôt une verticalité résolue. Pas tout à fait verticale, comme si elle portait en elle un petit souvenir de mouvement, mais avec une volonté indéniable de se redresser. Les arêtes sont inégales, lissées par les intempéries à certains endroits, ailleurs laissées délibérément anguleuses. Des lichens atténuent la dureté, des veines de quartz clair scintillent comme des fils de lumière figés. La pierre est profondément enfoncée dans le sol, non pas posée, mais enracinée ; tout autour, les pas du bétail, les traces d’humidité qui assombrissent le brun.
Soudain, l’image s’arrête. Ce qui coulait à l’instant se concentre. Les lignes se resserrent, les distances commencent à parler. À partir de là, l’étendue se redresse : le bord de la côte répond comme un cadre silencieux, une pente à peine perceptible s’élève de la surface, même le vent prend une direction, comme s’il passait à côté de cette pierre, et non au-dessus. On pourrait dissimuler la pierre en la recouvrant – avec la main sur la photo, avec le pouce intérieur dans le regard – et le détail retomberait dans la diversité. On le laisse tel quel, et la diversité devient un « ici ».
Le menhir n’est pas seulement une partie de la scène, il agit comme un opérateur silencieux qui transforme la scène en lieu. Sa verticalité est plus que de la statique ; c’est un geste humain inscrit dans la terre : prendre position. À l’extérieur, l’ordre se crée ; à l’intérieur, l’attitude s’éveille. Là où régnait l’indifférence, un centre se forme ; là où régnait la dérive, une orientation. Le paysage devient accessible, car on peut le lire à partir d’un point précis – à partir de cette pierre, à proximité de laquelle le chaos trouve sa place.
L’approche goethéenne : quatre phases
La « délicate empirie » de Goethe valorise la perception et fait échouer la pensée. D’abord le donné, puis le signifiant – non pas comme une contrainte temporelle, mais comme une question d’attitude. À partir de cette attitude, la rencontre – avec la pierre ou dans la compréhension intérieure – peut se dérouler en quatre phases riches en expériences :
1. Percevoir, ralentir. Permettre à la pierre d’être telle qu’elle est. Hauteur, inclinaison, arêtes. La peau mate des lichens, les veines de quartz comme de fines vagues solidifiées. Les ombres qui se déplacent au fil de la journée. Le positionnement dans le sol. La pente. Le souffle de l’air. Ce qui manque fait également partie de l’expérience : aucune inscription, aucune figure, seulement la forme. Pas encore d’interprétation. Présence, jusqu’à ce que les faits arrivent intérieurement – comme une image qui cesse d’être une image et qui est simplement là.
2. Mouvement (imagination exacte). Chaque forme porte un geste : enraciner et soulever, résister et rester immobile. Poursuivre le mouvement visible à l’intérieur – sans inventer. La pensée suit la perception, et non l’inverse. On sent que quelque chose veut se tenir ici. Pas d’obstination, mais du calme sous le poids. Pas de rigidité, mais une verticalité concentrée. On remarque alors que son propre corps réagit : les pieds plus écartés, les genoux plus souples, la respiration plus profonde. Non pas parce que l’on « devrait », mais parce que la forme y invite doucement.
3. Résonance. Une attention prolongée fait naître une atmosphère : recueillement, dignité, sentiment de seuil – pas de pathos, plutôt un silence évident. Pas de projection, mais ce que la forme suscite en moi. La pierre parle par la forme, l’âme répond par le son : « Reste debout ; sans dureté, sans indulgence. » Le cœur ne s’alourdit pas, mais s’éclaircit. Peut-être que le front se détend, peut-être que regarder devient simple.
4. Reconnaissance (essence). Revirement : la pierre n’est plus un objet, mais une présence. L’« essence » devient évidente – aussi réelle que la couleur, aussi tangible que le poids. Le paysage a désormais un centre. Le Je se redresse. Pas de choix entre l’intérieur et l’extérieur, mais une harmonie : point de vue à l’extérieur, position à l’intérieur. La pensée peut désormais trouver des mots, non pour remplacer la perception, mais pour la porter.
Cette séquence n’est pas une recette. C’est une prière de l’attention. Elle laisse apparaître le sens sans le forcer. Et elle laisse à l’ineffable son espace.
L’automne, temps de pause
On arrive dans la vaste plaine, le regard glisse, et soudain, quelque chose se dresse. C’est un vis-à-vis. Sa présence rassemble non seulement le lieu, mais aussi moi-même. C’est comme si la pierre tenait un miroir silencieux, dans lequel apparaît quelque chose de ma qualité d’être – cette verticalité tranquille qui n’est ni dure ni souple, mais simplement présente.
L’automne ne demande pas de performance, mais une attitude. C’est ainsi qu’il devient perceptible : point de vue à l’extérieur, position à l’intérieur. Non pas comme une règle, mais comme un événement. La pierre montre une certaine façon d’être, une modalité de présence à soi. En la regardant longuement, je m’examine doucement : ma propre verticalité est-elle solide ? Où en suis-je à la frontière entre la vastitude estivale et l’intériorité hivernale ? Cet examen n’est pas un jeu de pouvoir, ni une menace, mais un sérieux bienveillant, une introspection pour savoir si je suis prêt à franchir le pas vers une existence plus consciente, dans laquelle le Je n’est pas seulement spectateur, mais présent.
Un gardien près du Loch Buie (île de Mull)
À l’ouest de l’Écosse, sur l’île de Mull où je réside, s’ouvre la vallée de Loch Buie. À l’écart, silencieuse. En traversant les prairies marécageuses depuis le petit parking pour rejoindre le cercle de pierres, on passe devant un menhir isolé. Même de loin, il ne semble pas dominer le paysage ; il est large dans son geste, plat et légèrement bombé sur le côté, comme s’il avait les coudes tournés vers l’extérieur. Sa partie inférieure dégage une force qui l’ancre solidement et profondément dans le sol. Il est à peine plus haut qu’un être humain, mais suffisamment pour être un vis-à-vis.
J’ai conduit de nombreux groupes vers cette pierre et les ai invités à s’y arrêter. Inévitablement, quelque chose change à mesure que nous nous approchons. Les pas ralentissent, les voix s’atténuent. Certains restent à distance, comme si l’air était devenu plus dense. D’autres s’approchent prudemment, presque pas à pas, quelques-uns touchent la pierre. Tous se taisent. Tous les menhirs ne sont pas ainsi : certains sont joyeux, communicatifs, font rire le groupe, d’autres le rendent poète. Celui-ci inspire le sérieux. Et c’est comme s’il posait une question, sans paroles : es-tu prêt ? Es-tu sûr de toi ? Es-tu en accord avec toi-même, avant de poursuivre ton chemin vers le sanctuaire ?
Que l’on accomplisse les quatre phases consciemment ou non, la plupart des gens le remarquent : il se passe quelque chose ici. Quelque chose en moi résonne avec ce gardien. Il ne veut rien « de » moi. Il éveille quelque chose en moi. La question est silencieuse, non menaçante. On peut passer son chemin. Mais ceux qui lui accordent de l’espace, qui répondent à ce geste, ressentent cette douce mais sérieuse mise à l’épreuve de leur propre fermeté : non pas comme un jugement, mais comme une clarification.
Même si la rencontre directe avec un menhir a l’effet le plus fort, les photographies – comme celle jointes au texte – sont aussi utiles. Mais on peut également suivre la description intérieure : l’étendue horizontale, l’élément solitaire qui se dresse, le ralentissement du courant, la concentration qui se forme. Ce n’est pas le lieu qui est déterminant, mais la fidélité à l’expérience : perception, mouvement intérieur, résonance, reconnaissance – comme une attention silencieuse à une présence.
Ceux qui travaillent avec des images peuvent tenter le même jeu que dans le paysage : couvrir puis découvrir la pierre sur la photo avec le doigt, observer comment le motif et le centre changent, prêter attention à la façon dont le regard réagit. Ce n’est pas un substitut, mais une approximation, une compréhension qui montre que la forme n’agit pas seulement « là-bas », mais aussi dans le regard.
N’est-ce pas là une projection ? – La question est légitime. Trois antidotes suffisent :
- ancrage : perception sensorielle persistante avant toute interprétation ;
- polarité : ne pas interpréter – la perception guide, la pensée suit ;
- convergence : lorsque plusieurs observateurs mentionnent des qualités similaires, c’est que la forme parle.
Il n’en résulte aucune preuve, mais une clarté qui grandit à mesure que l’on s’y conforme. Et la clarté suffit souvent pour agir dignement : pas plus vite, mais avec plus de vigilance.
Verticalité
Une pierre dressée transforme le « partout » en « ici ». Cet ici crée le présent – et exige le présent en moi. En même temps, ces pierres gardent le seuil : elles ne testent pas durement, mais silencieusement – la sincérité morale, la vigilance et la volonté de saisir maintenant comme un fruit intérieur ce que l’été a fait mûrir en moi. Abandonner les illusions, renoncer aux rêves, parvenir à une constance énergique et éveillée dans la vérité. C’est la qualité que nous attribuons à Michaël. Et c’est la même que celle que le menhir évoque dans le paysage.
Heureusement, ces témoins sont nombreux en Écosse et dans les îles britanniques, et ils ont des frères et sœurs partout en Europe. Peut-être nous souvenons-nous d’une pierre que nous avons déjà rencontrée. Peut-être qu’une image ouvrira la même porte silencieuse. Peut-être que le chemin mènera un jour à l’un de ces monuments, que ce soit à Arran, au bord de la lande, ou à Mull, le long du sentier menant à Loch Buie. À chaque véritable rencontre avec un monument, nous rencontrons un peu de Michaël dans le paysage.
Au commencement était la question. À la fin reste un son – clair dans la pensée, fidèle dans la perception, calme dans la posture. Il n’en faut pas plus pour franchir dignement le seuil de l’automne.
Adaptation française
Béatrice Petit & ÆTHER X
Source

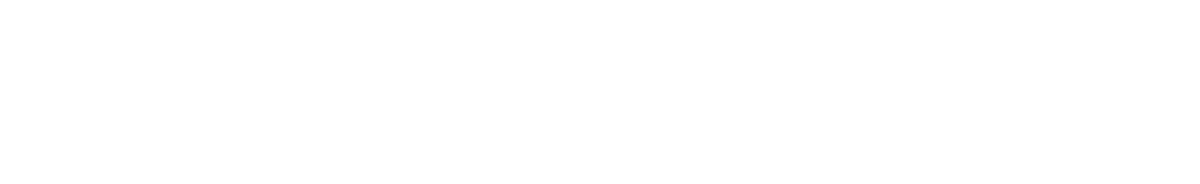
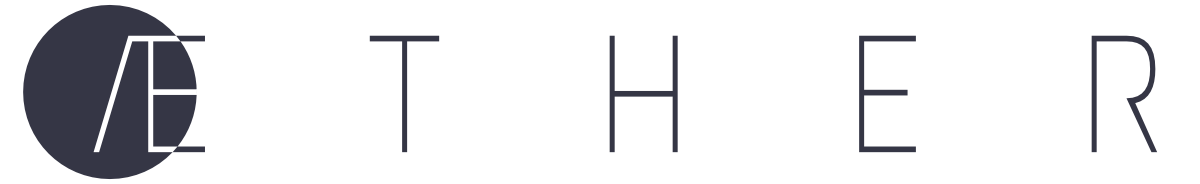








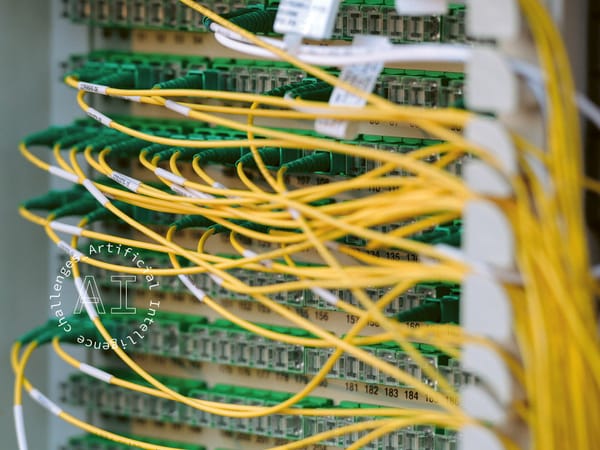


Discussion pour membres