La science serait-elle dans une impasse ? À la faveur de la crise Covid, la recherche scientifique a été invoquée pour justifier les mesures politiques les plus diverses, allant du confinement à l’instauration d’un passe « sanitaire », en passant par l’implémentation de campagnes de vaccination de masse. La plupart du temps à tort. Nous savons aujourd’hui que le confinement n’a servi à rien, que le passe n’a eu de sanitaire que le nom et que les vaccins n’empêchaient pas la transmission, rendant leur imposition en population générale caduque.
Des « experts » auto-proclamés ou adoubés par les grands médias ont pourtant répandu leur bonne parole pour convaincre la population que les mesures officielles étaient bonnes et qu’il fallait les suivre aveuglément. Leurs avis ont été largement écoutés, malgré la présence de voix discordantes très crédibles. Inutile de revenir en détail sur les aberrations de la crise Covid, qui ont déjà fait l’objet de nombreuses publications parfaitement étayées.
Soulignons simplement que cet épisode a fait office de révélateur d’une tendance de fond qui s’est répandue depuis une dizaine d’années au moins dans nos sociétés : l’instauration d’une logique d’inquisition sous couvert de rationalité pour défendre une certaine idée de la science, en fait contraire à ses fondements. L’esprit critique a été et reste dévalorisé, sauf quand il est du côté de la doxa, de la pensée dominante. La connaissance scientifique, pourtant fondée sur l’art du doute, construite patiemment par la formulation d’hypothèses mises ensuite à l’épreuve du réel est aujourd’hui circonscrite à certaines limites hors desquelles les pensées hétérodoxes sont vilipendées, rabaissées ou moquées sans aucun égard pour les faits. Des gardiens de la raison s’y emploient avec assiduité. Ils n’hésitent pas à contacter employeurs, organisateurs de conférences ou diffuseurs pour empêcher la tenue de tables rondes ou la programmation de documentaires considérés par eux comme gênants, n’hésitant pas à faire des appels ouverts à la censure.
Les dogmes de l’évolution
La zoologiste française Anne Dambricourt, par exemple, a fait l’objet d’une campagne de dénigrement pour avoir émis l’hypothèse d’une mémoire de la nature non identifiée, qui aurait conduit à une évolution humaine par paliers s’effectuant au niveau embryonnaire. Citée dans le dernier livre du journaliste Brice Perrier sur l’« obscurantisme au pouvoir », elle explique que son observation pose problème au néo-darwinisme, car « elle montre une logique interne à cette évolution qui ne dépendrait donc pas uniquement de l’adaptation à l’environnement et de la sélection naturelle ». Cette hypothèse va dans le sens des écrits de Teilhard de Chardin, pour qui le « phénomène humain » représentait l’étape cruciale de l’émergence d’une noosphère devant nous permettre de prendre conscience de notre participation à une réalité de nature spirituelle. La chaîne Arte, qui devait diffuser un documentaire à ce sujet, reçut des pressions des milieux rationalistes et zététiciens. Ces derniers ne purent empêcher la diffusion du film (aujourd’hui également disponible sur Netflix), mais ils contribuèrent à son bashing et à sa décrédibilisation dans l’espace médiatique, faisant passer la zoologue pour une néo-créationniste, ce qui impacta négativement la poursuite de ses recherches dans le cadre de sa thèse.
Certains débats ne peuvent donc tout simplement plus avoir droit de cité. « Sur certains sujets qui préoccupent, à juste titre, la société, une minorité dogmatique prend alors la parole, occupe le terrain et oriente l’opinion à son avantage par une sélection partisane d’observations », écrit Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuelle honoraire de l’Académie française des sciences, dans son livre Retour vers l’obscurantisme (2022). Ce faisant, c’est la démarche scientifique elle-même qui est attaquée, révélant l’existence en son sein d’une crise méthodologique profonde dont il faudra bien s’extirper pour retrouver… la raison (!) et ainsi repousser les limites traditionnellement assignées à la connaissance. En d’autres termes : réenchanter une science aujourd’hui engluée dans un matérialisme devenu dogmatique. Cette conception de la science, ancrée depuis le XIXe siècle, ne résiste plus à l’épreuve des faits. Elle se lézarde de toutes part, entraînant ses défenseurs à radicaliser leurs positions, jusqu’à la caricature et le déni de science.
L’homéopathie, un climat d’inquisition
Il serait possible de multiplier les exemples de cet état de fait. Prenons l’homéopathie. Régulièrement décriée par les tenants de la médecine dite « scientifique », cette pratique inventée au XIXe siècle par le médecin allemand Samuel Hahnemann (1755-1843) a fait l’objet de nombreux débats depuis deux siècles. Aujourd’hui, Thomas Durand, figure de proue de la chaîne de zététique La Tronche en Biais, considère que le débat n’a plus lieu d’être, tant la science a prouvé la charlatanerie de l’homéopathie. Proche de ce milieu rationaliste, le biologiste moléculaire, mathématicien et gilet jaune Alexander Samuel prône même ouvertement la mise à l’écart de cette pratique et des individus qui la défendent. En d’autres termes : sa censure. Qu’en est-il vraiment de la scientificité de l’homéopathie ?
S’il est vrai que la déontologie de certains praticiens homéopathes laisse à désirer, il n’en reste pas moins que de nombreuses études sérieuses attestent aujourd’hui, sans l’ombre d’un doute, que des traitements homéopathiques ont un effet au-delà du placebo. En octobre 2023, une revue systématique de six méta-analyses d'essais contrôlés randomisés, couvrant l'homéopathie individualisée et non individualisée ainsi que des essais incluant les deux types, a été publiée dans BMC Public Health. Les méta-analyses comprenaient entre seize et cent-dix essais.
Les résultats montrent que l'homéopathie présente un effet supérieur au placebo dans cinq des six analyses. Lorsque les analyses sont restreintes aux essais de haute qualité, trois sur quatre des méta-analyses conservent cet effet significatif, tandis qu'une seule n'a plus montré de différence significative avec le placebo.
Les conclusions de cette revue vont donc à l'encontre des propos de Thomas Durand ou Alexander Samuel. Selon les auteurs : « Contrairement à ce qui est souvent affirmé, les méta-analyses disponibles de l'homéopathie […] montrent des effets positifs significatifs au-delà du placebo. Par rapport à d'autres interventions médicales, la qualité des preuves de l'efficacité de l'homéopathie est similaire ou supérieure à celle de 90 % des interventions médicales ». En conséquence, concluent les auteurs, « les preuves d'efficacité des essais randomisés contrôlés par placebo ne justifient pas les actions réglementaires ou politiques contre l'homéopathie dans les systèmes de soins de santé. »
Les effets de la pratique homéopathique semblent donc raisonnablement attestés. En revanche, son corpus théorique est inexplicable par les lois connues de la physique et de la biologie. En particulier le principe de dilution, qui consiste à diluer la substance active d’un ingrédient utilisé comme médicament jusqu’à ce qu’il ne reste plus de molécules. Les expérimentations sur la « mémoire de l’eau », initiées par Jacques Benveniste dans les années 1980, puis reprises par Luc Montagnier, pourraient fournir un cadre explicatif cohérent. Vilipendées, elles mériteraient pourtant d’être poursuivies aujourd’hui, tant les étrangetés relevées sont intrigantes. C’est ce que préconise notamment le mathématicien français Cédric Villani, pour qui le dossier n’est pas clos. Problème : les suspicions irrationnelles et l’étiquette de pseudo-sciences entourant l’homéopathie n’incitent guère à financer de telles recherches. Ces dernières permettraient pourtant peut-être d’ouvrir la médecine à des horizons nouveaux, plus à même de répondre aux différentes dimensions psycho-spirituelles de la santé humaine, sans renier les acquis indéniables des pratiques allopathiques modernes.
Des EMI sans mort imminente
Selon Catherine Bréchignac, toujours citée par Brice Perrier dans son dernier livre : « Le fait que des lois connues n’expliquent pas, voire contredisent, un phénomène n’implique pas qu’il n’existe pas. Ces lois sont les outils dont on dispose aujourd’hui, mais il pourrait demain y en avoir d’autres. » Parmi les phénomènes que les lois physiques connues n’expliquent pas, se trouvent par exemple la prémonition ou la télépathie, étudiées en parapsychologie. La réalité des phénomènes « psi », qui mettraient en jeu une interaction entre le psychisme et son environnement, a fait l’objet d’une excellente synthèse publiée en 2018 dans American Psychologist par Etzel Cardena, professeur de psychologie à l’université de Lund, en Suède.
Les expériences en parapsychologie posent notamment la question de l’expérience subjective de la conscience, sur laquelle achoppe la science matérialiste. L’étude des « expériences de mort imminente » est une autre porte d’entrée à l’exploration de cette thématique. Les dizaines de milliers de témoignages concordants recueillis au fil des ans obligent ici les rationalistes dogmatiques à plus de prudence. Mais pour eux, il s’agit uniquement d’une forme d’hallucination cérébrale causée par un état particulier au moment de la « mort imminente ». Les témoignages individuels ne représenteraient d’ailleurs que le plus bas niveau de preuve scientifique.
La dénomination « d’expérience de mort imminente », cependant, est trompeuse. À force de récolter des témoignages, le docteur en médecine Jean-Pierre Jourdan s’est rendu compte qu’environ un tiers des EMIstes n’étaient pas dans une situation de mort imminente. Quel que soit le contexte, pourtant, les mêmes invariants revenaient dans le récit des témoins. Le neurologue Steven Laurey, du Coma Science Group de l’université de Liège, a confirmé ce fait dans une étude sérieuse comparant de véritables EMI et des EMI dites « like », survenues sans mise en danger du protagoniste. Jean-Pierre Jourdan a émis l’hypothèse que les EMIste auraient expérimenté une forme de conscience élargie, accédant à une sorte de dimension supplémentaire de la réalité suggérant que la source de l’univers pourrait bien être de nature spirituelle1. Compte tenu des observations faites dans des domaines aussi variés que la parapsychologie, la neurologie ou la physique quantique, cette hypothèse semble au moins aussi plausible que celle, réductionniste, faisant dériver toute vie biologique et psycho-spirituelle vers des interactions matérielles survenant au niveau subatomique.
Dit autrement, la prédominance actuelle du matérialisme réductionniste en science n’a rien de scientifique. Elle relève plutôt d’une croyance figée, devenue dogmatique. Pour le biochimiste anglais Rupert Sheldrake, la science est d’ailleurs bloquée dans son épanouissement par dix dogmes fondamentaux, incluant la croyance que l’esprit est produit par le cerveau ou que seule la médecine bio-chimique fonctionne. Avec des collègues, il publia en 2015 un manifeste pour une science post-matérialiste. On y lit que « le passage de la science matérialiste à la science post-matérialiste peut être d’une importance vitale pour l’évolution de la civilisation humaine. Ce passage peut être encore plus crucial que la transition du géocentrisme à l’héliocentrisme. »
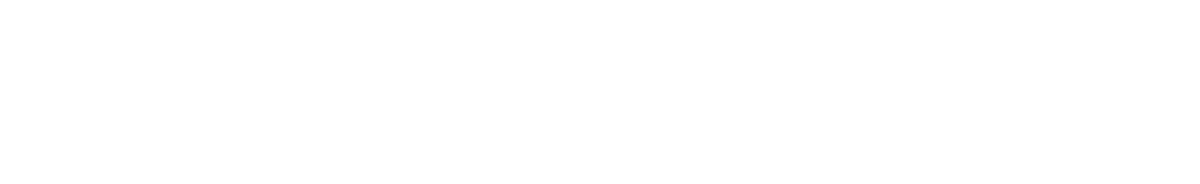
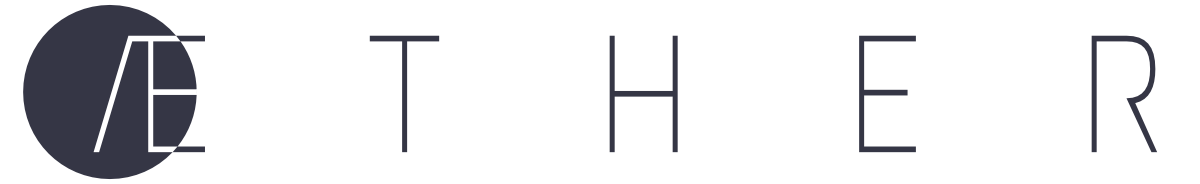



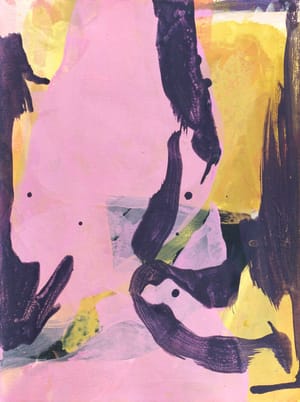



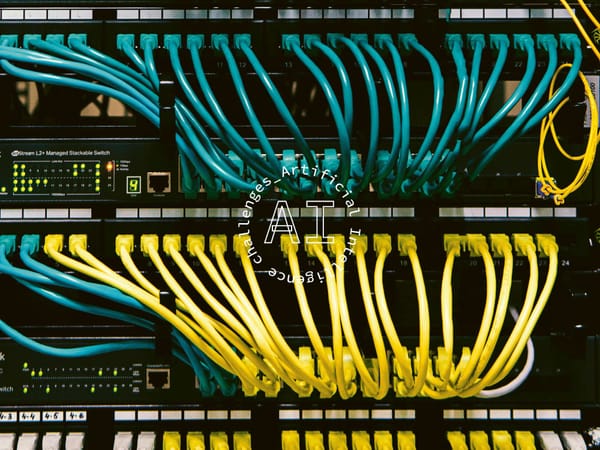


Discussion pour membres